1998 – Renversement et rétablissement de la culture conviviale
1998 – Renversement et rétablissement de la culture conviviale
Le sens de l’économie
La convivialité volée
Restaurer le politique
Sous le moindre prétexte, même le plus sympathique à priori, on nous ressert, en contradiction totale avec les aspirations flattées, la soupe doctrinale de la dominance moderne (individualisme, libéralisme, progrès, croissance, emploi…) ; cela, alors que les élites et les « gendarmes du monde » autoproclamés sèment partout le désastre.
C’est le moment de ne pas perdre de vue ce que cette modernité étendard de tous les appétits a créé comme souffrances et reculs de la vie, le moment aussi de revisiter les définitions premières.
Après « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » (Silence 233/234, juillet 1998) et l’amorce d’une démystification relative au sens de la liberté et de la démocratie, voici une réflexion sur les façons de comprendre l’économie et sa propre vie : extérieures à la vie des autres et au monde, ou parties intégrantes d’une construction commune ?
ce texte a été publié par l’éditeur Pli Zetwal, préface de Michel Ots

ISBN 2-9517455-1-6
.
.
pour communication de l’article et plus : <restaurplanet@gmail.com>
.
.
LE SENS DE L’ÉCONOMIE
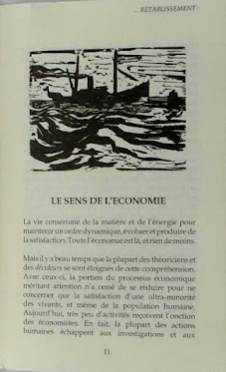


L’exploitation des sables bitumineux au Canada – pour accroître encore la consommation d’énergie fossile
Arasement de la biodiversité, bouleversement du climat local (sécheresses et méga-feux suivent), accroissement de la dérive climatique globale… Derrière lui, le système marchand ne laisse que désolation.

dessin de Errol le Cain
pour communication de l’article et plus : <restaurplanet@gmail.com>